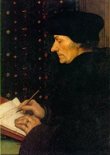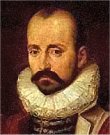L'humanisme
L'Humanisme fut d'abord une activité, un métier. Dès le XIIIe siècle, le premier usage d'"umanista" désigne le professeur de langues anciennes avec une connotation péjorative (le "pédant", le "grammairien") qui n'a rien de surprenante à une époque où les deux modèles de perfection humaine étaient le Saint et l'Héroïsme militaire. Qu'avait-on besoin d'un obscur anachorète de l'intellect passant son existence à traduire et commenter de vieux textes surannés et oubliés de tous ? Cependant, cet enseignement discret des langues anciennes allait susciter un intérêt sans cesse croissant pour les grands auteurs grecs et latins. L'Italie allait constituer un parfait terreau d'éclosion et d'épanouissement d'un véritable mouvement de retour à l'antiquité, deuxième définition que l'on puisse donner à l'Humanisme. En effet, le développement d'élites urbaines, l'arrivée de grecs fuyant l'avancée des turcs et porteurs de manuscrits et de traditions exégétiques puis la multiplication des traductions qui s'ensuivit permit à l'étude des langues anciennes (alliée à une exigence de pureté grammaticale nouvelle) de devenir systématique. L'invention de l'imprimerie, le développement définitif des villes, la création massive d'universités contribuèrent à une diffusion accélérée de cette (re)découverte des grands Anciens. Ce ressourcement de la pensée engendra un état d'esprit, un changement de perspective dans la perception que l'homme avait de lui-même et du monde dans lequel il vivait. C'est la troisième définition de l'Humanisme. La plus profonde et la plus durable. "On ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme" disait Pic de la Mirandole en 1486.
Le retour à la pensée antique remit en vogue certains thèmes et certaines notions; notamment celle latine de l'"humanitas": l'homme idéal est celui qui se réalise lui-même, atteignant le plus grand accomplissement intérieur grâce à l'étude des "lettre anciennes" (les fameuses "humanités": notion latine de l'"humanores litterae").
L'esprit humaniste est donc le grand introducteur de cette conception moderne de l'Humanité: l'homme digne de ce nom est celui qui a pour essence la culture. Plus qu'une philosophie, l'Humanisme est donc un vaste mouvement qui fédère par delà les disciplines, les pays et les moeurs tous les esprits animés par une quête de l'homme idéal et par une confiance dans le progrès de l'humanité. Lorsqu'au XVe siècle, l'Humanisme cantonné en Italie va rapidement se propager dans toute l'Europe, atteignant l'apogée de son rayonnement au cours du XVIe siècle; c'est tout un édifice capital de la pensée qui se construira... l'édifice de la Modernité.
Cette propagation rapide fut possible grâce à la combinaison de trois grands facteurs:
-Les grandes découvertes ouvrent des horizons nouveaux, fouettent l'imagination, suscitent de nouvelles réflexions et de nouvelles disciplines (comme la cosmographie de Mercator).
-La présence de souverains éclairés, de princes protecteurs ou de puissants épris de culture favorisent l'esprit nouveau...et son financement: François Ier en France, les Médicis (Cosme puis Laurent) à Florence, Mathias Corbin en Hongrie, le cardinal Cisneros en Espagne...
-Enfin, le développement de l'imprimerie facilite la diffusion des traductions des grands Anciens mais aussi des oeuvres humanistes comme celle d'Erasme qui vit dans la région d'Europe la mieux pourvue en villes, riche en échanges culturels et première zone d'expansion de l'imprimerie et des foires aux livres: la Hollande.
Au XVIe siècle, l'Humanisme rayonne et est devenu le mouvement emblématique du renouveau de la pensée et de la sensibilité européenne qu'est la Renaissance. Parmi les principales figures humanistes; des peintres (Vinci, Dürer, les Holbein, Metsys), des philosophes (Bacon, Vives, Thomas More), des moralistes (Montaigne, Rabelais, Erasme) mais aussi des médecins, des astronomes, des sculpteurs, des philologues comme Guillaume Budé, des imprimeurs influents et prestigieux comme Etienne Dolet. Mais cet esprit de conquête ne va pas sans résistance. Trois domaines sont particulièrement affectés par l'irruption de l'esprit humaniste: l'enseignement, la religion et la politique.
Le triple combat de l'Humanisme
L'éducation
Dans sa volonté de réaliser un modèle humain, l'humaniste porte un souci particulier à la formation de l'enfant d'où les nombreux traités de pédagogie (Vives, Erasme, T. Eliot, Murmellius,...) mais aussi les virulentes critiques adressées à l'enseignement de tradition médiévale (Rabelais, Montaigne, caricatures de Bruegel...). Face aux universités sclérosées par le formalisme, le dogmatisme stérile de la scolastique; les humanistes pronent une éducation libérale caractérisée par le respect de la personnalité de l'enfant, le savant dosage entre effort intellectuel et jeu, la pratique des auteurs anciens, un dialogue fécond entre le maître et l'élève. Le mouvement humaniste finira par triompher des vieilles universités médiévales (citadelles aristotéliciennes comme la Sorbonne en France), leur substituant des établissements humanistes dont les plus prestigieux furent le Collège des Lecteurs Royaux (futur Collège de France), St Paul à Londres, le Corpus Christi (Collège d'Oxford), Deventer (Pays-Bas), le "Gymnase" strasbourgeois de Sturm, le Collège trilingue (Latin, Hébreux, Grec) de Louvain, l'Alcala de Hénarès en Espagne.
La religion
La redécouverte des valeurs morales encloses dans la littérature gréco-latine et l'affirmation d'une liberté de l'homme par la pensée ont souvent engendré des conflits avec l'Eglise et ses doctes attachés à la lettre de la Tradition ou au ritualisme. En effet, l'humaniste pousse à une indépendance d'esprit, un libre examen des textes religieux qui sont vite perçus comme subversifs. Ainsi, l'imprimeur humaniste Dolet sera brûlé comme hérétique et athée à Paris en 1546.
La politique
Caractérisée par l'amour du peuple, le pacifisme, l'esprit oecuménique et la volonté d'équilibre entre les pouvoirs; la pensée humaniste est également amenée à tenter d'influer sur les décisions politiques. Se considérant comme appartenant à la "République des Lettres" qui serait sans frontière; les humanistes les plus éminents font toujours passer les intérêts moraux et permanents avant les intérêts politiques (matériels et temporels). Ce fut le sens des activités d'Erasme auprès de Charles Quint, de Budé auprès de François Ier ou de Thomas More auprès d'Henri VIII. En adressant aux quatre grands (Charles Quint, François Ier, Henri VIII et Ferdinand de Habsbourg) les "Quatre paraphrases sur l'Evangile" (en 1522-1523) afin d'empêcher une guerre européenne; Erasme fit là le geste le plus représentatif de ce que put être l'esprit humaniste sans frontière.
L'Humanisme eut une prodigieuse postérité, une foisonnante fortune. Qu'on en juge. Une forme d'humanisme imprégna largement l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle positiviste expliquait par l'entremise d'A. Comte qu'il s'agissait de substituer une "religion de l'homme" à la religion de Dieu. Et au cours de notre siècle si prompt à malmener la notion humaniste d'être humain, on peut évoquer l'humanisme marxiste, l'humanisme existentialiste, l'humanisme de l'"Autre" d'Emmanuel Levinas, l'humanisme de Camus ou de Malraux...
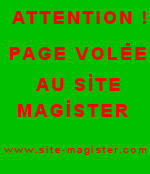 |
François RABELAIS (1494-1553)
Pantagruel (1532) texte original / texte modernisé. Comment Pantagruel étant à Paris reçut des lettres de son père Gargantua, et la copie d'icelles-ci. |
|
Très cher fils, |
Très cher fils, D'Utopie, le dix-sept mars, |
Questions :
- L'évocation d'une époque : dans sa lettre Gargantua souligne les profondes mutations des temps nouveaux. Recensez-les. Comment se manifeste son enthousiasme ?
- « Un abîme de science » : faites l'inventaire des disciplines énumérées par Gargantua. Comment s'exprime sa volonté de rassembler ici un savoir encyclopédique ?
- « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » : montrez que ce savoir ne se contente pas d'être livresque. En quoi vise-t-il à former l'âme plus que l'esprit ?
2. « Un homme réellement expert et rompu à la pratique »
Avant les rationalistes et les encyclopédistes, les humanistes ont été soucieux de fonder le savoir sur l'expérimentation (on pourra utilement comparer le texte ci-dessous à La dent d'or de Fontenelle). C'est en autodidacte que le céramiste Bernard Palissy prévient ici son lecteur, dans un avertissement où l'on pourra apprécier une profession de foi faite d'humilité et d'arrogance.
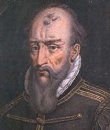 |
Bernard PALISSY (1510 env.-1590)
Discours admirables des eaux et fontaines (1580) texte modernisé |
|
Ami lecteur, le désir que j'ai de te faire profiter de la lecture de ce livre m'a incité à t'avertir de ceci : garde-toi d'enivrer ton esprit de sciences écrites en chambre, selon une théorie imaginaire ou arrachée à quelque livre écrit par l'imagination de ceux qui n'ont rien pratiqué, et garde-toi aussi de croire les opinions de ceux qui disent et soutiennent que la théorie a engendré la pratique. Ceux qui enseignent une telle doctrine utilisent un mauvais argument en disant qu'il faut imaginer et se représenter la chose que l'on veut faire, avant de mettre la main à sa besogne. Si l'homme pouvait exécuter tout ce qu'il imagine, je prendrais leur parti et soutiendrais leur opinion . Mais tant s'en faut ! Si les choses conçues en esprit pouvaient s'exécuter, les souffleurs d'alchimie feraient de bien belles choses et ne s'amuseraient pas à chercher durant cinquante ans, comme beaucoup l'ont fait... Si la théorie figurée dans les esprits des chefs de guerre pouvait s'exécuter, ils ne perdraient jamais une bataille...! | |
Questions :
- L'éloge de la pratique : par quels arguments Palissy démontre-t-il sa supériorité sur la théorie ? En quoi sa stratégie est-elle bien fidèle à la thèse qu'il soutient ?
- Le registre polémique : relevez les procédés par lesquels Palissy remet en question le principe d'autorité qui, depuis le Moyen Âge, fortifiait une croyance aveugle dans le savoir livresque.
- Un souci pédagogique : montrez l'intérêt des « collections » évoquées par l'auteur pour « satisfaire la vue, l'ouïe et le toucher ».
3. « Ne viser qu'au bien général »
Avant les philosophes, les humanistes ont eu une vocation pour conseiller les Princes (Machiavel, Thomas More, Erasme). Pacifistes, c'est au nom de la raison qu'ils imaginent une cité idéale où le monarque, loin des artifices de la Cour, manifesterait la vertu politique qui le rendrait garant du bien public.
Didier ERASME (1469 env.-1536)
Éloge de la Folie, LV (1511)[Dans ce traité, le philosophe hollandais utilise une prosopopée
qui donne la parole à la Folie. On n'oubliera pas que c'est elle qui s'exprime dans ce faux éloge qui condamne la superbe et la corruption des princes.]
Depuis longtemps, je désirais vous parler des Rois et des Princes de cour; eux, du moins, avec la franchise qui sied à des hommes libres, me rendent un culte sincère. À vrai dire, s'ils avaient le moindre bon sens, quelle vie serait plus triste que la leur et plus à fuir ? Personne ne voudrait payer la couronne du prix d'un parjure ou d'un parricide, si l'on réfléchissait au poids du fardeau que s'impose celui qui veut vraiment gouverner. Dès qu'il a pris le pouvoir, il ne doit plus penser qu'aux affaires politiques et non aux siennes, ne viser qu'au bien général, ne pas s'écarter d'un pouce de l'observation des lois qu'il a promulguées et qu'il fait exécuter, exiger l'intégrité de chacun dans l'administration et les magistratures. Tous les regards se tournent vers lui, car il peut être, par ses vertus, l'astre bienfaisant qui assure le salut des hommes ou la comète mortelle qui leur apporte le désastre. Les vices des autres n'ont pas autant d'importance et leur influence ne s'étend pas si loin; mais le Prince occupe un tel rang que ses moindres défaillances répandent le mauvais exemple universel. Favorisé par la fortune, il est entouré de toutes les séductions; parmi les plaisirs, l'indépendance, l'adulation, le luxe, il a bien des efforts à faire, bien des soins à prendre, pour ne point se tromper sur son devoir et n'y jamais manquer. Enfin, vivant au milieu des embûches, des haines, des dangers, et toujours en crainte, il sent au-dessus de sa tête le Roi véritable, qui ne tardera pas à lui demander compte de la moindre faute, et sera d'autant plus sévère pour lui qu'il aura exercé un pouvoir plus grand. En vérité, si les princes se voyaient dans cette situation, ce qu'ils feraient s'ils étaient sages, ils ne pourraient, je pense, goûter en paix ni le sommeil, ni la table. C'est alors que j'apporte mon bienfait : ils laissent aux Dieux l'arrangement des affaires, mènent une vie de mollesse et ne veulent écouter que ceux qui savent leur parler agréablement et chasser tout souci des âmes. Ils croient remplir pleinement la fonction royale, s'ils vont assidûment à la chasse, entretiennent de beaux chevaux, trafiquent à leur gré des magistratures et des commandements, inventent chaque jour de nouvelles manières de faire absorber par leur fisc la fortune des citoyens, découvrent les prétextes habiles qui couvriront d'un semblant de justice la pire iniquité. Ils y joignent, pour se les attacher, quelques flatteries aux masses populaires. Représentez-vous maintenant le Prince tel qu'il est fréquemment. Il ignore les lois, est assez hostile au bien général, car il n'envisage que le sien; il s'adonne aux plaisirs, hait le savoir, l'indépendance et la vérité, se moque du salut public et n'a d'autres règles que ses convoitises et son égoïsme. Donnez-lui le collier d'or, symbole de la réunion de toutes les vertus, la couronne ornée de pierres fines, pour l'avertir de l'emporter sur tous par un ensemble de vertus héroïques; ajoutez-y le sceptre, emblème de la justice et d'une âme incorruptible, enfin la pourpre, qui signifie le parfait dévouement à l'État. Un prince qui saurait comparer sa conduite à ces insignes de sa fonction, rougirait, ce me semble, d'en être revêtu et redouterait qu'un malicieux interprète ne vînt tourner en dérision tout cet attirail de théâtre.
Questions :
- « C'est alors que j'apporte mon bienfait » : quelles sont ces consolations apportées par la Folie ? Quels autres noms donner à celle-ci si l'on pense à la condition des rois (pensez à la formule de Pascal : « Un roi sans divertissement est un homme plein de misères ») ?
- La satire : quelles accusations essentielles condamnent l'exercice futile et corrompu de la monarchie ? Quels en sont les principaux procédés littéraires ?
- Le monarque idéal : après en avoir rapidement brossé le portrait, tel qu'il se dégage implicitement ou explicitement de ce texte, vous pourrez le rapprocher de l'idéal philosophique du despote éclairé (cf. par exemple le chapitre XVIII du Candide de Voltaire, ou l'article "Autorité politique" de l'Encyclopédie de Diderot).
4. L'humanisme en question
La foi humaniste s'épanouit en dépit de l'héliocentrisme de Copernic, qui retire à l'homme son rang de créature élue dans l'univers. Mais le déchaînement de la barbarie au Nouveau Monde et plus encore celle des guerres de religion ne manquent pas de la nuancer. Montaigne, avant les autres, confie son scepticisme à l'égard de la raison humaine : « Est-il possible de rien imaginer d'aussi ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, se dise maîtresse et impératrice de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut de la commander ? ».
Michel de MONTAIGNE (1533-1592)
Essais, II, 12, Apologie de Raimond Sebond (1580)[A la demande de son père, Montaigne avait traduit la Théologie naturelle du philosophe catalan Raimond Sebond. Il compose ici (peut-être sur l'invitation de Marguerite de Valois) une bien curieuse Apologie qui, par le scepticisme qu'elle manifeste, bat en brèche les idées de l'auteur qu'elle doit défendre : quand ce dernier établit l'homme en souverain de la création, Montaigne accumule en une cascade d'exemples autant de signes évidents de l'insuffisance de la raison humaine.]
texte original / texte modernisé
Questions :
- Reformulez en une phrase la thèse de Montaigne.
- Le recours à l'apologue et à l'exemple personnel : montrez que Montaigne le privilégie sur le raisonnement abstrait. Pourquoi ?
- Commentez la dernière phrase. Faut-il conclure au pessimisme de Montaigne (cf. la phrase suivante, qui peut éclairer son vrai projet : « [L'homme] s'élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main; il s'élèvera abandonnant et renonçant à ses propres moyens, et se laissant hausser et soulever par les moyens purement célestes ») ?
Jean-Philippe
miconijeanphilippe@yahoo.fr